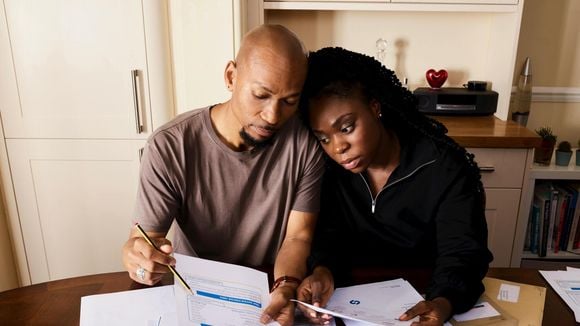





“It’s not about the money, money, money”, chantait Jessie-J au début des années 2010 et si on a tendance à ne pas vouloir mêler amour et argent pour ne pas venir ternir la romance, cela reste un vrai sujet au sein du couple, notamment les couples hétérosexuels.
Bien qu’on vive dans un monde plus égalitaire qu’en 1950, les disparités économiques subsistent bel et bien encore aujourd’hui entre les hommes et les femmes. Sans compter qu’on est encore loin de s’être détachés des normes dictées par le patriarcat, qui pèsent également leurs poids dans la balance quand il s’agit de souligner les inégalités.
Néanmoins, pour beaucoup, se mettre en couple est aussi synonyme de partage égalitaire des dépenses et ce sans nécessairement prendre en compte les différences de salaire, le poids de la charge contraceptive ou même de la charge des tâches domestiques et de l’éducation des enfants.
Car si on prend en compte le fait que les femmes gagnent généralement moins que leur conjoint, prennent plus sur le temps pour le dédier à l’éducation des enfants et/ou aux courses, à l’entretien du domicile conjugal et se chargent de payer les frais liés à la contraception, diviser les dépenses en deux parts égales jouerait en la défaveur des femmes.
Quand on parle de partager les dépenses à parts égales dans un couple, on oublie souvent de regarder ce qui se cache derrière les chiffres. Car si l'égalité semble être la solution idéale sur le papier, elle ne prend pas en compte toutes les réalités invisibles qui structurent nos vies et nos relations.
Dans son livre "Les grandes oubliées", Titiou Lecoq développe ce qu'elle appelle "la théorie du pot de yaourt". Un concept simple mais terriblement révélateur : quand on fait les courses en couple, qui achète le pot de yaourt ? Qui pense à renouveler le papier toilette, le dentifrice, les couches du bébé ? Ces petites dépenses quotidiennes, souvent considérées comme anodines, sont majoritairement prises en charge par les femmes.
Ces achats récurrents et en apparence peu coûteux individuellement, finissent cependant par s'accumuler jour après jour et finissent par représenter une part non négligeable du budget.
De leur côté, les hommes ont plutôt tendance à se charger de ce qu’on appelle les "grosses" dépenses, plus importantes mais moins fréquentes, comme l'électroménager, la voiture, les vacances...
Le problème ? Même quand on croit faire "moitié-moitié", la répartition réelle des dépenses peut être très déséquilibrée. D’autant plus que des achats, comme une voiture ou un lave-vaisselle, restent dans le temps, contrairement au fameux pot de yaourt qui, lui, finit à la poubelle.
De fait, si jamais il y a séparation, l’homme peut conserver les biens dans lesquels il a investis alors que la femme n’a que des pots de yaourt vides. Et c'est sans compter tous ces produits spécifiquement féminins (protections hygiéniques, contraception...) qui alourdissent encore la facture du côté des femmes.
"Il faudrait que les hommes réalisent qu'ils n'auraient pas les carrières qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes, parce qu'ils devraient gérer leur famille beaucoup plus. Le travail gratuit des femmes génère de la valeur pour les hommes, parce que ça leur génère du temps et des opportunités. Mais ce travail gratuit n'apporte pas de revenus, et même si monsieur dépense plus pour la famille, c'est une vision très court-termiste, car lui va pouvoir capitaliser sur son travail rémunéré, tandis qu'on ne capitalise pas sur le travail gratuit. Il aura des cotisations chômage, des cotisations retraite, ce qui ne sera pas le cas d'une femme qui diminue ses revenus et son activité au nom de la famille."
Ces mots de Lucile Quillet, journaliste et autrice de l'essai "Le prix à payer : Ce que le couple hétéro coûte aux femmes", mettent le doigt sur un problème systémique. Au-delà des dépenses immédiates, c'est toute une économie parallèle qui se met en place dans le couple. Une économie où l'un des partenaires investit son temps et son énergie dans des tâches non rémunérées mais essentielles, pendant que l'autre peut se consacrer pleinement à sa carrière.
Et cet investissement invisible a un prix : celui des opportunités manquées, des promotions refusées, du temps partiel choisi "pour le bien de la famille". Un prix qui se paie cash au moment de calculer sa retraite ou en cas de séparation.
Cette organisation, qui peut sembler pratique à court terme, crée en réalité une forme de précarité différée pour les femmes. Dans un système où le 50-50 est la règle, elles se retrouvent doublement pénalisées : elles contribuent autant financièrement que leur conjoint malgré des revenus souvent inférieurs, tout en assumant la majorité du travail domestique non rémunéré.
La sociologue Françoise Milewski l'a bien démontré : les inégalités économiques entre les sexes se creusent avec l'âge et l'arrivée des enfants. Plus on avance dans le temps, plus le fossé se creuse entre les trajectoires professionnelles féminines et masculines, avec des conséquences directes sur l'autonomie financière.
Face à ce constat, il apparaît clairement que le strict partage 50-50 des dépenses ne fait que reproduire, voire amplifier, les inégalités existantes. Alors quelle alternative ?
C'est peut-être du côté de l'équité, plutôt que de l'égalité, qu'il faut chercher la réponse. Car l'équité, contrairement à l'égalité, ne consiste pas à donner la même chose à chacun, mais à donner à chacun selon ses besoins et ses moyens.
Concrètement, cela peut prendre plusieurs formes. Certains couples optent pour une contribution proportionnelle aux revenus : chacun participe aux dépenses communes à hauteur de ses moyens. D'autres intègrent dans l'équation le temps consacré aux tâches domestiques et familiales, considérant qu'il s'agit d'une contribution à part entière à l'économie du foyer.
D'autres encore mettent en place des mécanismes de compensation pour rééquilibrer les sacrifices de carrière : épargne commune, assurance-vie, ou simplement une prise en charge plus importante des dépenses par celui qui a le salaire le plus élevé.
L'important n'est pas tant la formule choisie que la démarche : prendre conscience des inégalités structurelles, en parler ouvertement, et chercher ensemble des solutions qui permettent à chacun de préserver son autonomie financière sans sacrifier la dimension affective de la relation.

















