 "La terre des femmes", une ode à la nature, à la terre, aux femmes.© Adobe Stock
"La terre des femmes", une ode à la nature, à la terre, aux femmes.© Adobe Stock

María Sánchez est une jeune vétérinaire native de Cordoue, dans le sud de l'Espagne. De son enfance paisible en Andalousie, elle a retenu un dur labeur, celui, considérable, de toutes ces femmes, épouses et mères de famille qui, aux champs et près des animaux, se sont assurées de la bonne santé du monde rural. Paysans, agriculteurs, éleveurs, sont des mots qui bien trop souvent s'écrivent au masculin. Une erreur que l'autrice vient rectifier.
Car avec La terre des femmes, cette trentenaire délivre un récit intime et militant sur ces travailleuses trop longtemps invisibilisées. Alors que les (très) jeunes générations clament haut et fort le respect de la terre, de la planète et de la nature (c'est le cas du mouvement Youth for climate par exemple), María Sánchez s'intéresse aux mères et grands-mères qui ont su porter élevages et territoires fertiles sur leurs épaules.
Une déclaration d'amour inter-générationnelle qui n'est pas la moindre des qualités de ce bel ouvrage. Pourquoi donc s'y plonger ? C'est simple.

 © Editions Rivages
© Editions Rivages
Sorti l'an dernier en Espagne, Tierra de mujeres a déjà été maintes fois réimprimé, fort de son succès. Normal, cette parution comble un vide. La jeune autrice met à l'honneur d'admirables anonymes qui rarement squattent le haut de l'affiche. A savoir, "celles qui ont travaillé la terre et veillé sur elle sans jamais être reconnues", nous dit-elle en note d'intention. C'est en renouant avec sa propre généalogie que l'artiste rend visible ce qui est enfoui.
C'est-à-dire ? Et bien, ces femmes "de la maison" et de la nature, "qui étaient comme des fantômes qui erraient au foyer, faisant et défaisant, à l'ombre du frère, du père, du mari", écrit-elle, s'occupant aussi bien des bêtes que des animaux. La société rurale que décrit María Sánchez est faite d'héroïnes mutiques qui ont bien des récits à raconter mais qui, toujours, s'en retrouvent privées. Celles qui toute leur vie se sont salies les mains, sont allées nourrir les poules, ramasser les olives, cultiver les plantes, "ces femmes aux genoux terreux incrustés de gravillons".
En grandissant, la "petit fille de" s'est rendue compte que les auteurs des manuels vétérinaires et textes scientifiques, mais aussi les bergers, agriculteurs et poètes de la nature célébrés à travers toute l'Espagne appartenaient au même sexe. "C'étaient toujours des hommes qui posaient sourire aux lèvres près de leurs animaux, en protagonistes, propriétaires, soigneurs. Où étaient passées les femmes ?", s'interroge-t-elle. En les positionnant au coeur de l'imaginaire littéraire, ce témoignage leur réattribue une présence forcément vitale.

 © Adobe Stock
© Adobe Stock
La terre des femmes est donc un devoir de mémoire riche en anecdotes, allant de l'édifiant à l'émouvant. Édifiant, lorsque l'autrice nous apprend qu'en 2013, le pourcentage de femmes travaillant dans les secteurs de l'élevage, la foresterie et la pêche ne représentait que 2,2 % des femmes "officiellement actives" dans l'Espagne rurale, d'après une étude institutionnelle. "Le fait est que les femmes sont doublement discriminées. D'abord en raison de leur genre, ensuite en raison de l'environnement dans lequel elles vivent et travaillent", déplore Maria Sánchez, qui voit en la campagne et en celle qui la sert "non pas un visage unique, mais une multitude".
Émouvant, par les trajectoires familiales que le récit invoque. Loin des clichés les plus archaïques, les portraits qui en découlent dénotent par leur modernité. On pense notamment à cette scène où la grand-mère Carmen offre à sa petite-fille un service à café, des théières et assiettes, soit "un trousseau de femme indépendante". Et la grand-mamie d'ajouter : "Je te prépare et t'offre un trousseau, mais ce n'est pas la peine que tu te maries, tu te débrouilles très bien toute seule". Croustillant.
 © Adobe Stock
© Adobe Stock
"Nous devons nous exprimer, élever la voix, écrire. Le monde rural et ses femmes ont besoin d'une littérature qui raconte la vérité. Nous avons besoin d'un féminisme qui dépasse la brèche géographique, valable pour celles qui estiment qu'elles ne méritent pas d'être entendues", écrit l'autrice. Son manifeste, María Sánchez le rédige au nom "d'un féminisme de soeurs et de terre". Un combat qui s'écrit au passé (en rendant hommage au matrimoine des "citoyennes invisibles" d'hier) mais aussi au présent : sont énoncées les violences sexuelles faites aux migrantes qui cultivent les terres. L'une des raisons pour lesquelles il ne faut plus se taire.

Désirer un "féminisme rural" n'exclut en rien l'étendue des villes, au contraire : c'est souhaiter une inclusion de toutes, juste et universelle, des territoires terreux aux lieux publics. La vétérinaire l'affirme d'ailleurs, avec l'éloquence des slogans qui ponctuent les manifestations et marches militantes : "Nous voulons des femmes dans tous les espaces. Que ce soient elles qui racontent, forment et construisent. Nous nous insurgeons contre l'absence de femmes quelque part, dans un quelconque événement. Nous élevons la voix, écrivons, manifestons".
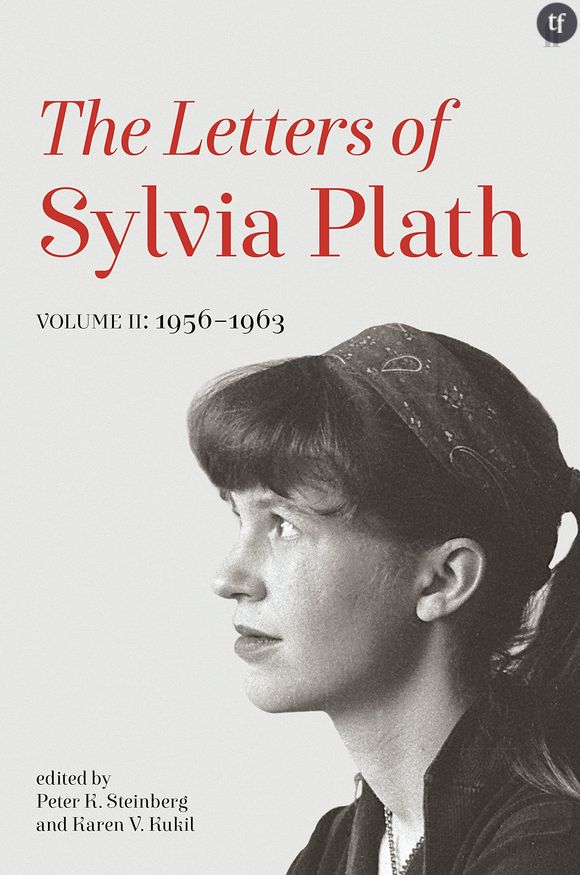 © Faber & Faber
© Faber & Faber
Politique, ce récit sororal ? Bien sûr, et poétique aussi. Rien d'anodin à ce que María Sánchez cite la poétesse féministe Sylvia Plath et ses évocations lyriques de la Nature ("Quand j'étais enfant, j'ai aimé un nom rongé par le lichen", "As a child I loved a lichen-bitten name"). On retrouve au fil des lignes la même écriture organique, qu'il soit question de paniers d'oeufs (qui sont comme des madeleines de Proust) ou "d'épis plantés dans la poitrine", de mauvaises herbes et de potagers, de mains pleines de terre et de vergers sur lesquels s'attardent les rayons du soleil.
De ces images d'enfance émane une célébration de la Nature comme féminité plurielle et complexe, protectrice et vulnérable, alourdie de souvenirs et de (re)naissances. L'artiste aime ainsi à penser "à la force de l'eau comme à une mère qui berce et chante des mots doux, qui métamorphose peu à peu ses enfants tout en changeant elle-même, sans le savoir". Chez María Sánchez, les saisons s'alternent comme autant de récits de femmes. Ils se disent à proximité des rivières et des érosions, des clôtures et des bocaux vides.
La terre des femmes, par María Sánchez
Editions Rivages, 166 p.

 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle
 play_circle
play_circle